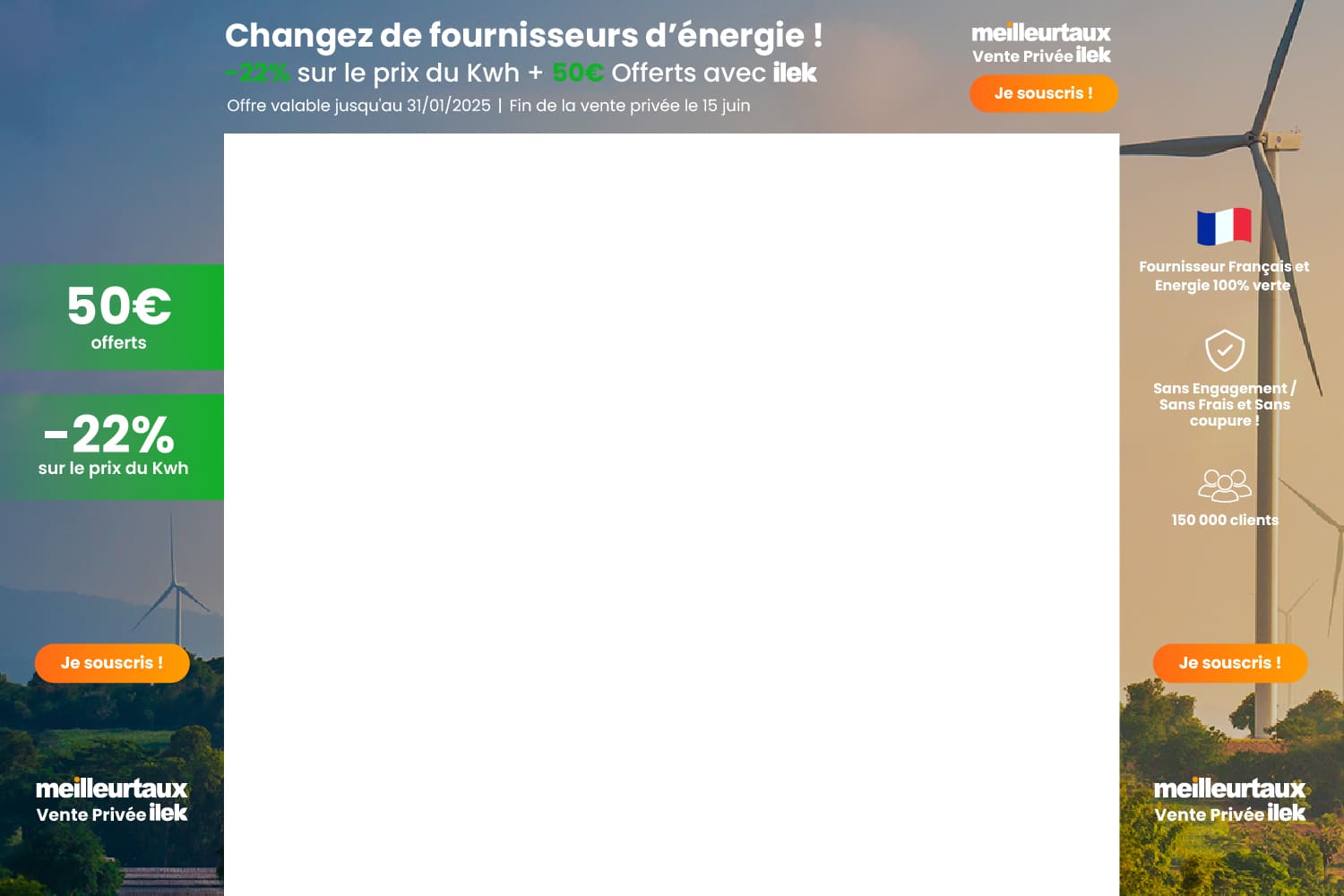PRESIDENTIELLE 2022 - Les autorités régulant les différents secteurs de la consommation prononcent régulièrement des sanctions à l'égard d'acteurs sortant des clous. Ces décisions sont publiées en ordre dispersé et donc invisibles du grand public. Elles sont pourtant de nature à éclairer nos choix de consommation. Parmi ses 10 propositions adressées aux candidats à la présidentielle, MoneyVox propose de les rassembler dans un répertoire national facilement accessible.
Comment ça fonctionne aujourd'hui ?
AAI ou API : ces deux acronymes désignent les autorités indépendantes (administratives ou publiques) chargées de réguler certains domaines de la vie économique et sociale française. Leur rôle, notamment, est de repérer, sanctionner et dénoncer les dérives des acteurs de ces domaines. Toutes sont construites, peu ou prou, sur le même modèle, encadré notamment par une loi de 2017 qui a réduit le nombre de ces autorités. La plupart d'entre elles possèdent des « commissions des sanctions », qui prononcent mesures conservatoires, injonctions, voire sanctions pécuniaires à l'endroit des contrevenants aux règles encadrant leur secteur de référence.
Selon le site gouvernemental vie-publique.fr, ces autorités sont actuellement au nombre de 26. Si l'on restreint le périmètre aux sujets de consommation au sens large, il en reste 7 :
- l'Autorité de la concurrence ;
- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;
- l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;
- la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ;
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
- le Défenseur des droits ;
- le Médiateur national de l'énergie.
On peut ajouter à cette liste deux autres autorités habilitées à sanctionner et intervenant dans des secteurs concernant le grand public :
- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), rattachée à la Banque de France
- la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), rattachée à Bercy.
Qu'est-ce qui cloche ?
Lorsqu'elles sanctionnent, ces autorités rendent publiques leurs décisions. Sauf rares exceptions, comme celle de l'AMF qui prévoit que sa « commissions des sanctions peut décider de publier cette dernière sous une forme anonymisée dans les cas où cette publication serait susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ou lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier (...). »
Ces sanctions, en effet, sont de nature à éclairer certains choix de consommation. Grâce à la publicité qui leur est faite, elles permettent, par exemple, d'éviter de s'engager avec un fournisseur d'électricité ou d'internet sanctionné pour ses mauvaises pratiques commerciales, ou avec une banque ne respectant pas la réglementation en matière de commissions, pour reprendre des cas de figure récents ayant donné lieu à des sanctions.
Toutefois, même disponibles dans l'espace public, ces décisions ne parviennent pas toujours à toucher un large public. Cela tient aux conditions dans lesquelles elles sont publiées. Chaque autorité se charge de le faire sur son propre site web, où elles se retrouvent souvent perdues dans le flux des décisions et actualités. Ainsi, un consommateur qui souhaiterait s'informer en autonomie sur le sujet en est réduit à mettre en place une politique de veille de ces sites. A défaut, il peut consulter les associations ou la presse spécialisée, qui font souvent office de caisse de résonance, mais sans assurance d'exhaustivité.
Ce qu'il faut changer en 2022
Pour permettre à tous de s'informer de manière complète et autonome sur les pratiques des acteurs publics et privés dans le domaine de la consommation, MoneyVox propose de créer un « guichet unique » où un particulier, un professionnel, un journaliste, une entreprise, une association peut venir consulter, de manière intuitive et exhaustive, les entités sanctionnées et les raisons de ces sanctions.
Ce « guichet » pourrait prendre la forme d'un répertoire national public, accessible sur le web et alimenté par les différentes autorités.
Ce qu'il faut modifier dans la loi
Pour créer ce nouveau répertoire, il faudra en passer par une nouvelle loi. Le texte pourrait par exemple être composé :
- d'un premier article créant le répertoire, décrivant son contenu et indiquant les entités qui le gèrent (ou sous quelle autorité il est placé) ;
- d'un deuxième article traitant de ses modalités d'accès
- d'un troisième article renvoyant ses modalités de mise en œuvre à un décret en Conseil d'Etat.
Les 10 propositions de MoneyVox pour la présidentielle
L'élection présidentielle est généralement l'occasion pour les candidats de parler économie, sécurité ou éducation. Mais rarement de répondre aux problèmes rencontrés par les Français avec leurs fournisseurs de services (banque, assurance, énergie, télécom...) et qui, parfois, leur empoisonnent la vie et leur font perdre beaucoup d'argent.
Fort d'une expertise reconnue et d'un large auditoire sur les finances personnelles et le budget, MoneyVox a souhaité proposer aux candidats à la présidentielle 10 pistes concrètes pour améliorer le quotidien des Français et leur pouvoir d'achat. Le tout dans un souci de pragmatisme, d'efficacité, et bien sûr dans un esprit non-partisan.
Ces propositions seront transmises aux candidats déclarés, et MoneyVox vous tiendra informé de leurs éventuelles réponses.
1- Forfait mobile, box internet, SVOD... Imposons une résiliation simplifiée !
3- Démarchage : permettons d'annuler le contrat après la première facture
4- Permettons le transfert d'assurance vie à tous les contrats, sans perte fiscale
5- Facilitons la résiliation de l'assurance emprunteur à tout moment
6- Crédit immobilier : supprimons les indemnités de remboursement anticipé
7- Frais bancaires : interdisons la facturation sans information préalable
8- Refondons le Livret A pour protéger l'épargne populaire
9- Facilitons le recours à la médiation pour les litiges de consommation
10- Mettons en place un guichet unique des prestataires condamnés